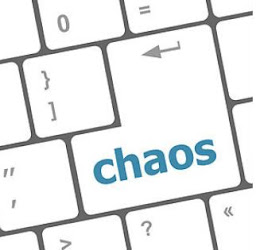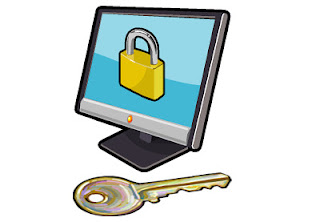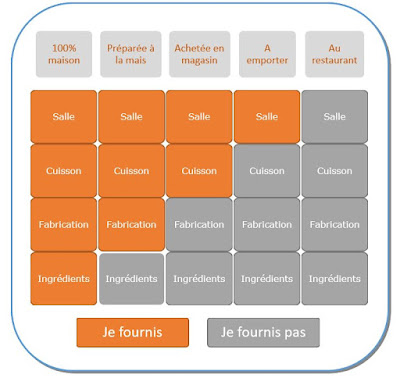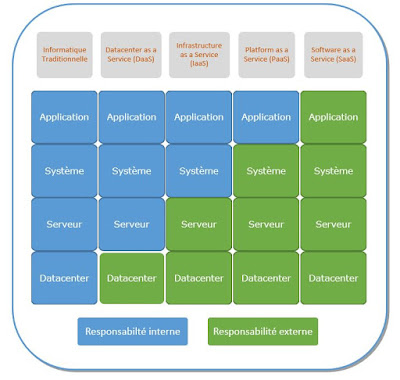Je suis né à Mont-de-Marsan, dans une famille d’immigrés espagnols. Tous les dimanches soir, à 120 km des émetteurs de La Rhune, depuis la cuisine de notre appartement au quatrième étage de notre cité, sur un transistor d’époque en ondes longues, mon père et quelques amis écoutaient en direct la retransmission des matchs de football de la première division espagnole, pour valider leurs paris sportifs de la semaine.
Dans ma jeunesse, dès que j’avais un moment, c’est au foot que je jouais avec mes amis, sur le terrain vague au centre de notre cité. Rocheteau, Keegan, Platini, c’est eux qui ont bercé mon enfance. J’étais foot à 100%. Tout naturellement, je me suis inscrit au club de foot du Stade Montois, mais la concurrence était rude, je n’étais pas particulièrement doué, et c’est finalement au club de volley-ball que je me suis éclaté sportivement.
Le rugby, c’était pas mon truc. Mes potes n’y jouaient pas, on n’en parlait pas, et pourtant, c’était un monument invisible à ma porte.
Par contre, le rugby surgissait les samedis après-midi en fin d’hiver, pour le tournoi des 5 nations, et aux beaux jours pour les phases finales du Championnat, voire même un test match contre la Roumanie en fin de saison. Et comme j’aimais profondément le sport en général, je regardais ces matchs de rugby, écoutait Couderc puis Albaladejo, essayais de comprendre ce jeu bizarre et j’ai fini par avoir aussi mes joueurs préférés, au sein des grandes équipes de Béziers, d’Agen, du Stade Toulousain, de l’équipe de France, du Pays de Galles…
Puis je suis parti faire mes études à Aire-sur-Adour, puis Bordeaux. J’ai quitté Mont-de-Marsan, sa rue Gambetta, son magasin de sports, où j’allais parfois repérer un short ou une paire de chaussettes. Ce magasin portait le nom d’un ancien joueur de rugby, André Boniface, dont j’avais quand même saisi qu’il avait été un grand joueur de rugby.
Arrivé sur la côte basque au début des années 90, j’ai vite été plongé dans un univers où le foot était inexistant, car le rugby saturait l’espace sportif, en particulier à cause de la proximité géographique des deux clubs de l’Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique. Ici, tout le monde parlait rugby, plusieurs amis jouaient ou avaient joué au rugby, entrainaient dans des clubs, le rugby était partout, chacun était soit pour Aviron, soit pour le BO, comme à Madrid on est pour l’Athletico ou pour le Real.
Les 30 années qui ont suivi ont été, sans surprise, profondément marquées par le rugby : supporter du BOPB au début, membre fondateur de l’association Handi-BO, deux garçons à l’école de rugby de l’Anglet Olympique dont un (Manuel) joueur à l’Aviron Bayonnais et l’autre (Pablo) journaliste sportif pour Midi Olympique. Au fur et à mesure de mon immersion dans le rugby, je découvrais aussi la place du Stade Montois dans l’histoire du rugby, ses gloires passées, la fin tragique de Guy Boniface, le parcours exceptionnel de son frère, ce héros que je n’avais pas su capter à l’époque.
Jusqu’au jour où le fiston journaliste, sachant mon admiration pour André Boniface, me propose de l’accompagner à Hossegor, fin 2017, pour une séance photo avec André, dans le cadre d’un article à paraître dans Midol.
J’étais comme un gosse. On a passé un petit moment, on a blagué sur Moun, sur le rugby. Je l’ai conduit à la plage pour quelques photos, dans ma petite Chevrolet Spark rouge (c’est une tradition, puisque ma petite Hyundai Atos noire avait eu précédemment les honneurs de Jean-Michel Gonzalez avec mon ami Pascal Jeanneau en chauffeur affûté), puis nous nous sommes quittés avec une dédicace de “Nous étions si heureux”. Journée inoubliable pour un montois, qui rajoutait enfin une pièce essentielle dans son puzzle rugbystique.
André est parti rejoindre son frère, et tous les amoureux du beau geste. Handi-BO lui rend hommage.
[Article publié sur : http://www.handi-bo.org/2024/04/andre-boniface.html]